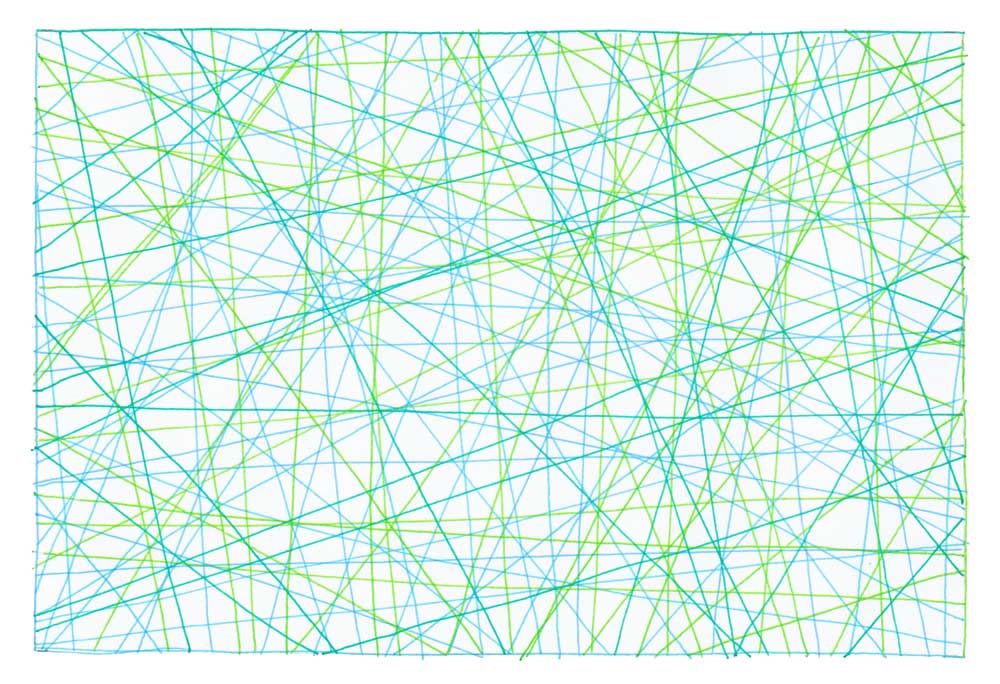
Elle n’était jamais pressée. Revenant de la fac, elle s’attardait volontiers dans les rues, hiver comme été. Elle regardait autour d’elle, cherchant sans chercher, n’hésitait pas à sourire, quand elle en avait l’occasion n’hésitait pas à parler. Elle aimait échanger quelques mots, trois fois rien, un mot pour un autre. En parlant avec des étrangers, elle ne pensait pas s’engager. Elle trouvait simplement qu’ainsi la vie paraissait plus légère, souvent s’avérait imprévue, à proprement parler inimaginable. Un instant, elle avait l’impression d’échapper à sa destinée. Elle deviendrait prof, sans doute. Sans doute elle se marierait et aurait un ou deux enfants. Mais pour l’instant, elle était quelqu’un à qui l’on pouvait se confier. Pour l’instant, elle était avant tout cela, une jeune fille sachant écouter, une âme prête à tout entendre.
Non loin de chez elle vivait un homme —si l’on admet que c’est une vie que de rester continuellement sur le trottoir— à qui elle avait déjà donné quelques pièces. Il n’était pas là tous les jours ; la nuit, elle ne savait pas où il dormait. Mais quand il était là, il ne faisait qu’attendre, emmitouflé dans une couverture. Il ne disait jamais merci, se contentait de plisser les yeux.
Il était difficile de lui donner un âge. Il avait l’air fatigué mais son corps était athlétique. Il avait l’air aussi de ne pas être à sa place —si toutefois c’était là une place pour un homme, une place où un autre homme aurait pu s’asseoir. Pour le dire autrement, qu’il soit assis sur le trottoir frisait l’invraisemblable. Et pourtant il était là, attendant toujours, parfois sous la pluie, souvent dans le froid, attendant quoi ?
Une jeune fille est naturellement curieuse. Si elle ne l’est pas, eh bien tant pis pour elle ! Un jour, Laure osa demander à l’homme si la couverture lui tenait assez chaud, et pour la première fois elle entendit sa voix. Une voix rauque, une voix que Laure n’aurait pu prévoir et dont le timbre était si troublant qu’il perturbait ce qu’elle était en train d’émettre. Aussi la réponse de l’homme fut perdue dans le vent et, plutôt que l’obliger à répéter, Laure préféra poursuivre la conversation par un sourire qui n’engageait à rien, croyait-elle. Ensuite, comme elle ne pouvait continuer à sourire plus longtemps, elle ne trouva pas mieux que s’enfuir, laissant l’homme à sa place, et livré à quelque pensée.
Le lendemain, toute rouge, elle s’excusa. Il n’y avait pas de quoi mais elle insista, disant qu’elle avait honte d’être une passante tandis que lui était condamné à rester sur le trottoir. Mais si ! continua-t-elle, et en plus je pose des questions dont je n’écoute même pas les réponses, c’est un comble, ne trouvez-vous pas ? L’homme s’offrit aussitôt à ne plus lui répondre, espérant par là lui être agréable : elle pourrait ainsi lui poser toutes les questions du monde tandis que lui continuerait à se taire, ce qui l’arrangeait, elle devait le croire. Ne seraient-ils pas heureux comme ça ?
Laure comprit qu’il la taquinait. La suite de l’histoire prouvera qu’elle se trompait. Pour le peu qu’il parlait, l’homme parlait le plus sérieusement du monde. Ils seraient heureux comme ça.
Ils se revirent les jours suivants mais le monde avait changé. Elle n’était plus une simple passante et il était devenu une personne plus complexe qu’un homme à qui on fait la manche. Le trottoir était désormais une scène où ils ne se regardaient qu’à la dérobée, en voleurs, en gens ayant désormais une faute sur la conscience. Elle lui offrait des pommes qu’il ne croquait que lorsqu’elle avait le dos tourné.
Mais toujours, même en retard, elle parvenait à lui glisser quelques mots. Quand elle en avait le temps, elle en disait davantage, lui racontait ses journées, lui parlait de sa destinée. Vous me voyez en prof ? Moi-même, je n’arrive pas à y croire.
Et puis elle dissertait sur la marche du monde. Injustice, inégalité, racisme : tous ces mots étaient à sa bouche. Elle savait qu’elle n’aurait pas dû mais elle ne pouvait s’empêcher de parler d’abondance. D’autant qu’il semblait boire ses paroles.
Toujours, au moment de le quitter, elle finissait par lui poser des questions qui, disait-elle, n’attendaient pas forcément de réponses mais que, au cas où il y en eût, elle écouterait certainement. Leur sourire simultané confirmait qu’il se tramait entre eux quelque chose. Et —rompant en quelque sorte leur pacte— il consentait alors à livrer certaines vues sur sa personne.
Ainsi petit à petit apprit-elle des secrets qui n’en étaient pas vraiment et qu’une autre fille plus méfiante que Laure aurait pu assimiler à un tissu de mensonges. Il s’appelait Robin, avait rompu avec sa famille, avait passé sa jeunesse à voyager, ne s’était pas soucié de l’avenir, ne le regrettait en aucune façon.
Toujours, cela ne prit pourtant que plusieurs semaines. Un matin et les matins suivants, il n’était plus là.
Un choc. Un coup au cœur. C’est ce que Laure ressentit. Un coup auquel elle ne s’attendait pas. Comment aurait-elle pu s’y attendre ? Un choc pareil, jusqu’ici elle ne connaissait pas. Jamais auparavant devant elle la terre ne s’était ouverte. Jamais elle n’avait eu à subir les assauts d’un raz-de-marée. Comment aurait-elle pu s’y attendre ? Du jour au lendemain, un être lui manquait, un être que pourtant elle connaissait à peine, qui n’était rien pour elle, qui n’avait pas de place dans sa destinée. Du jour au lendemain, tout avait changé. Elle aurait voulu le voir, elle aurait voulu lui parler. Là, à l’instant. Mais ce n’était plus possible, la mer en se retirant ne laissait qu’un trottoir désolé. Ce n’était plus possible de le voir plisser des yeux, de le voir ramener sur ses épaules la couverture qui glissait, de le voir d’un revers de la main s’essuyer la bouche, quand il n’y avait plus rien à boire, quand elle avait fini de parler. Ce n’était plus possible et pourtant ce n’était rien, si peu de chose. Si ça avait été quelque chose, qu’en aurait-il été ?
Il fallut bien s’habituer. Il fallut bien reprendre. Repasser par le chemin au bord duquel naguère Robin l’attendait. Elle ne parvenait pas à comprendre pourquoi il n’était plus là, ni pourquoi ça lui faisait quelque chose à ce point-là. Non, elle ne parvenait pas à comprendre pourquoi, s’il n’était rien pour elle, elle continuait à regretter qu’il ne fût point là, juste là, sans parler d’écouter qu’il ne fût point là juste pour la voir passer. Pourquoi n’était-il pas resté ? Pourquoi un jour lui avait-elle parlé ? S’était-il lassé ? De paroles ne l’avait-elle pas saoulé ?
Quand il reparut, c’est comme si on lui avait ôté un poids sur le cœur. Son cœur de femme bondit à nouveau dans sa cage. Son cœur fut soudain le ballon affolé que l’homme n’avait plus qu’à viser.
Il reparut avec un sac de sports à ses côtés. Laure se refusa à poser des questions et de toute façon il n’aurait pas répondu. Elle lui avoua cependant qu’elle était heureuse de le voir. Il répondit que oui, il était heureux aussi.
Il ne fut pas long à venir, le temps où elle l’invita chez elle. Il pourrait être au chaud, il pourrait se reposer, il pourrait prendre un bain.
Il la suivit, prit un bain, resta, s’installa.
Les trois premières nuits, il dormit sur un canapé. A la quatrième, elle lui ouvrit ses bras.
Au début, il ne sortit pour ainsi dire pas de chez elle. Il avait trouvé un refuge. Les mots de Laure étaient infiniment chaleureux. Elle posait des questions pour la forme, pour mieux avancer dans ses pensées, pour se garder de toute affirmation qui les aurait tous deux ligotés, pour faire du doute une manière de vivre au jour le jour, pour se moquer du lendemain et de la destinée. Bien sûr il ne répondait pas. Il se contentait de plisser les yeux et de s’essuyer la bouche. Et le fou rire les prenait.
Le jour même où il avait emménagé, il avait sorti du sac de sports une petite toile enroulée. Le tableau représentait une île avec à son sommet une croix.Un îlot plutôt, un monticule de terre. La croix était probablement là en mémoire de quelque naufrage. Le ciel était sombre, à l’horizon le soleil jetait encore son éclat. Une sorte de brume était posée sur tout cela.
Robin avait déroulé la toile et l’avait épinglée sur un mur. En silence. Sans commentaire.
Maintenant Laure regardait la toile avec l’attention que l’on porte aux choses d’un être aimé. Elle ne se préoccupait pas de son côté lugubre, fascinée qu’elle était par la lumière au loin qu’elle interprétait comme une aurore, l’annonce d’un mystère qui allait bientôt se lever. C’était évident, une vérité était sur le point de lui être révélée.
Comme il ne voulait décidément pas sortir, elle le laissait seul durant toute la journée. A son retour, il était impatient de la déshabiller. Il lui faisait l’amour avec gravité, presque brutalement et sans presque la regarder, paraissant entièrement concentré sur le plaisir qu’il prenait avec elle. Quand il s’accordait un répit, il consentait alors à lui sourire avec tendresse, juste avant de reprendre son déhanchement saccadé.
Elle dut bientôt prendre un boulot de serveuse dans un restaurant. Les soirées étaient dorénavant comptées.
Robin refusait obstinément de travailler. Il arrivait que Laure en soit agacée.
Il pouvait partir si elle le désirait. Non, ce n’est pas ce qu’elle désirait, elle désirait plutôt qu’il se sente libre, ce n’est pas elle qui l’avait enfermé. Lui, qu’est-ce que vraiment il désirait ?
Un instant il la regardait. Davantage, ses yeux la pénétraient. Puis il mettait un doigt vertical en travers de sa bouche, comme pour l’enjoindre à se taire, ou encore pour signifier la nature de ce qu’il désirait.
Elle hésitait à ouvrir de nouveau la bouche. Elle se demandait pourquoi, ce type, elle s’était mise à l’aimer. Elle se demandait pourquoi, quand il s’endormait, elle ramenait la couverture sur ses épaules. Pourquoi elle s’était mis en tête de le protéger. De lui donner le gîte et le souper. Pourquoi ?
Pour rien au monde elle n’aurait voulu revenir en arrière, et en même temps elle se disait que ce type, peut-être, n’était pas digne d’être aimé.
Ils vécurent ainsi à peu près un an. Dans l’entourage de Laure, on la trouvait changée. Elle paraît heureuse, disait-on, mais elle a vieilli. Laure laissait dire. S’il était vrai qu’elle avait perdu son teint de jeune fille, elle était devenue du moins une femme avec une histoire, une histoire dans laquelle il était raconté qu’elle faisait corps avec un homme qui sur le trottoir avait attendu pendant des années qu’elle vienne à passer, un homme qui de temps en temps lui chuchotait à l’oreille qu’il n’y avait de beau que le présent, que c’était du présent qu’il fallait profiter, que le présent valait bien l’éternité. Elle ne pouvait être que d’accord avec cet homme, et c’est sans doute sur cet accord-là qu’était fondé son amour. Elle considérait que c’était là une belle histoire d’amour, qu’il n’y avait pas lieu de regretter d’avoir changé ni même d’avoir vieilli. Elle aurait aimé laisser dire pour l’éternité mais le présent, un jour, en deux s’était cassé. Un jour, hélas, il y eut un passé et il y eut un futur. Ce jour-là, Robin s’était tout simplement barré. D’un coup, d’un seul, il avait tiré un trait sur leur belle histoire d’amour.
Il avait disparu en plein jour. En revenant de la fac, elle remarqua aussitôt que le tableau manquait. Robin n’était pas du genre à laisser derrière lui un souvenir. Ou peut-être savait-il que Laure n’aurait besoin de nul objet pour peupler ses insomnies de souvenirs. Après tout, il la connaissait. Comment aurait-il pu ne pas savoir qu’en partant comme un voleur il lui léguait par force un passé qui allait être lourd à porter, qui toutes les nuits allait la réveiller, en pleurs, sans épaules pour la consoler ?
Le mur était vide. Une épingle y était encore enfoncée.
Elle voyagea.
Elle alla jusqu’en Inde. Elle vit les gens allongés sur les trottoirs, elle vit la misère assemblée. Elle connut la chaleur et la poussière. Le désarroi lui collait constamment à la peau mais elle était loin d’être seule à porter sa croix. Elle se disait : je devrais avoir honte de moi.
Elle revint.
Au passage elle prit quelques amants. Mais ce n’était rien, cette fois absolument rien du tout. Ils avaient raison : elle avait vieilli. Elle ne pouvait plus prétendre être la jeune fille qui attendait tout de la vie.
Elle devint prof mais le cœur n’y était pas. Elle n’y croyait plus, elle avait perdu la foi.
Bien des années plus tard, elle croisa un homme sur qui aussitôt elle se retourna.
L’homme était en costume et portait une mallette. Grand, athlétique, il aurait pu ressembler à Robin si on lui avait ôté la barbe. Laure resta un instant interdite. Et puis, sa curiosité l’emporta.
Elle s’étonnait de suivre un homme. C’était bien la première fois. En tout cas c’était la première fois depuis longtemps qu’elle éprouvait ce quelque chose qui impérativement l’incitait à épier, à filer l’homme jusqu’à la banque où il entra.
Une ressemblance physique induit-elle une ressemblance de caractère ? Pour posséder des traits communs les gens sont-ils les mêmes ? Non, bien sûr que non. Il y a pourtant de quoi intriguer, il y a pourtant de quoi se demander, de se demander jusqu’à aller vérifier. Tel air familier réveille tel souvenir. Une chanson surgie du passé nous fait retrouver une sensation oubliée. On est ravi —ému, même— de la retrouver. On est à ce point ravi qu’on n’est pas pressé de la lâcher. On tente de la suivre jusqu’au bout pour vérifier en somme que nous n’avons pas changé, qu’avec nous le monde n’a pas bougé davantage, que c’est toujours la même chanson.
Bien que son travail à la fac lui laissât pas mal de temps, elle commença néanmoins à manquer des cours. Cela prend du temps, de suivre et d’attendre, d’attendre et de suivre. Parfois, elle ne le voyait pas passer. Elle oubliait les heures et le reste et parfois elle allait jusqu’à s’oublier elle-même. La conscience endormie, elle se fiait à son instinct pour donner l’alarme.
Cela faisait longtemps déjà qu’elle savait tout de cet homme. Elle savait que dans la banque il était haut placé, qu’il habitait un appartement cossu, qu’il avait une femme et un enfant qui devait avoir dans les cinq ans. L’homme paraissait heureux. Il n’y avait pas de raison pour qu’il ne le fût pas. Son sort était enviable. Plus d’un aurait voulu être à sa place.
Là où elle semblait se réveiller, là où elle le suivait volontiers, où elle était le plus intriguée, c’était lors de longues promenades qu’il faisait en solitaire, le plus souvent dans les cimetières. Il arpentait les allées nonchalamment, au hasard probablement. De temps à autre il s’arrêtait sur une tombe, l’air pensif. Quelle était-elle, cette pensée ? Lorsqu’il s’éloignait, Laure se mettait à sa place, tâchait de comprendre ce qui avait pu l’arrêter. Mais elle ne voyait que des noms inconnus et des dates qui ne disaient pas grand chose. Nous sommes les uns pour les autres des étrangers.
Elle avait beau le suivre et l’attendre depuis plusieurs mois, elle ne comprenait pas pourquoi elle le suivait, elle ne comprenait pas pourquoi elle s’acharnait à l’attendre, elle ne voyait pas la raison. C’était une obsession, il n’y a pas de raison dans l’obsession. Quelque chose hors de son entendement la poussait à le suivre, la poussait à l’attendre, à l’attendre quelquefois des heures sur le trottoir, sous la pluie, dans le froid, parfaitement immobile. Quelquefois, des gens lui donnaient la pièce. Elle rougissait mais ne bougeait pas.
Ce n’était plus une vie. Elle avait beau chercher comment elle en était arrivée là, elle ne voyait pas la liaison qui l’avait fait passer de jeune fille ne demandant qu’à connaître l’amour en fantôme qu’un homme —l’homme— ne remarquait même pas.
Il lui tournait le dos, toujours. Naturellement, il lui tournait le dos. Comment aurait-il pu en être autrement ? Il était tout à fait impossible de l’aborder. C’était au-dessus de ses forces. Elle était trop fragile, trop incertaine. Elle avait peur de rompre le charme, de couper le cordon qui la reliait à ce dos. Elle avait peur de se vider d’un coup de sa substance et de sur place se liquéfier. Elle avait peur de le voir s’éloigner, de le voir disparaître, encore disparaître. Elle avait peur de s’écrouler.
Un soir, elle le vit entrer chez un antiquaire. Il faisait jour encore au moment où il était entré, et nuit déjà quand il avait fini par sortir.
Elle ne le vit pas le lendemain ni le surlendemain ni les jours qui suivirent ni les semaines qui suivirent. La femme et l’enfant étaient là mais lui avait disparu. L’évidence était là.
Mais l’évidence était plus que difficile à admettre. Inadmissible était cette nouvelle disparition. Dans ce monde, les hommes semblaient condamnés à disparaître et les femmes à rester. Il était difficile de concevoir un monde pareil. Il était contre-nature de laisser une femme seule sur le trottoir, apeurée, tournant sur elle-même, ne sachant plus que faire, ayant perdu sa raison d’être, ne sachant plus si elle devait en rire ou pleurer.
Il est des ressources insoupçonnées. Il n’entrait pas dans son destin de s’écrouler.
Laure finit par avancer, par prendre une direction. Mais le chemin qu’elle emprunta alors ressemblait rue pour rue à un chemin déjà parcouru, et tous les chemins qu’elle fit ensuite —le lendemain, le surlendemain, les jours qui suivirent, les semaines qui suivirent— la mirent à nouveau dans les pas d’un homme qui n’existait plus.
A nouveau elle traversa les cimetières. A nouveau elle s’arrêta sur des tombes anonymes. Pas plus qu’autrefois elle ne comprenait ce que ces noms et ces dates voulaient dire. Et pourtant elle écoutait, et pourtant sur les marbres elle se penchait —un peu plus bas, toujours plus bas— mais elle continuait à ne rien entendre. Ou bien elle était sourde, ou bien les morts étaient muets. En tout cas la communication ne passait pas. Elle était seule, murée en elle-même. C’était inadmissible mais il fallait bien l’admettre. Elle aurait été folle de ne pas admettre une chose pareille —la solitude— à laquelle nul ne pouvait échapper. C’est leur isolement même qui reliait les hommes entre eux. Des tombes dans un cimetière, c’est ce qui faisait d’eux des hommes. Seuls et néanmoins côte à côte. Elle aurait été folle de croire que l’amour pouvait être au-dessus de cela, pouvait réunir des destins séparés. L’amour ne pouvait tout au plus que mêler des noms et des dates, mais qu’y avait-il à comprendre ? Rien. Surtout, il ne fallait pas chercher.
Ses pérégrinations la menèrent inévitablement devant la vitrine de l’antiquaire.
Elle reconnut aussitôt la toile. C’était l’île et c’était la croix. C’était au loin la même lumière. La même brume était sur tout cela.
C’était la toile assurément et cependant elle semblait modifiée. Le cadre, sans doute. Un énorme stuc doré encadrait maintenant l’île de la croix et le tableau avait changé.
