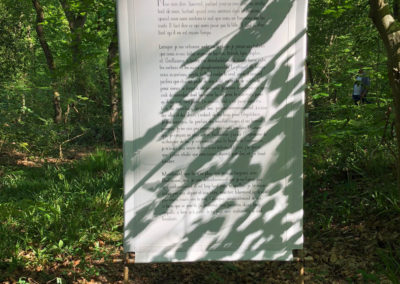Les Valleuses
Installation réalisée en collaboration avec Sandrine Granon en 2018, pour Les Valleuses, sentier artistique à Varengeville-sur-mer, sous la direction artistique de David Moinard.
Il s’agissait de créer deux sites entre les trois valleuses de Varengeville pour faire découvrir les lieux : nous avons choisi des endroits qui nous ont paru particulièrement propices au recueillement, puisque le but était de faire lire des paroles que des vivants adressent aux morts afin de se sentir plus vivants. Les textes étaient calligraphiés sur des pages de toiles tendues entre des bambous, formant ainsi de petits enclos auxquels on accédait en suivant des chemins de bannières aux couleurs du paysage alentour (mer et ciel, falaises). Nous souhaitions faire « sortir au grand air » les arts traditionnels que sont littérature et peinture pour à la fois les vivifier et les désacraliser.
Les Valleuses | I
Lorsqu’il fait soleil et que tout invite à la sieste, dès que je m’allonge dans l’herbe, dès que je ferme les yeux, c’est plus fort que moi, je ne pense qu’à toi. Il me semble que ta tête est restée près de ma tête. Il me semble recevoir le souffle de ta bouche, mais c’est sans doute le vent, sans doute l’air venu de la mer. Il me semble que tu vas bientôt me parler, me dire encore une fois que tu as envie de moi, mais je crains que ce ne soit le murmure du vent ou le chant de la mer. Puis il me semble que ton corps bascule au-dessus du mien et je ne peux résister, déjà mes lèvres vont à la rencontre des tiennes. Hélas, je n’embrasse qu’un fantôme, un corps absent qui pourtant pèse de tout son poids sur mon corps qui réclame son dû, qui réclame la joie, encore la joie, qui sait bien depuis déjà trop longtemps qu’on ne se lasse jamais de la joie.
Te souviens-tu ? Après avoir fait l’amour, nous sommes restés un instant immobiles, puis je t’ai dit que j’avais un peu froid. Nous nous sommes relevés, nous avons regardé la mer qui dormait au-dessous de la falaise, et nous avons traversé le pré, pour moi tu as écarté les barbelés. Et puis, nous nous sommes à nouveau embrassés. Tu as ri, et c’était comme si toute ta jeunesse jaillissait de tes lèvres. Maintenant que je ne suis plus jeune, je sais que ce rire ne nous appartient pas. Il appartient au vent, il appartient à la grâce. Il appartient à qui veut le prendre, à qui veut le récupérer au passage. Tous les amoureux me font songer à nous. Tous me font sourire, et ce sourire n’est pas amer. Il me relie au monde. Il me rappelle toutes les fois où j’ai été vivante, si vivante entre tes bras que plus rien n’existait que le ciel, que ces nuages qui passaient loin au-dessus de moi, là-bas, les merveilleux nuages.
Les Valleuses | II
Nous ne devrions jamais nous priver de parler, même pour ne rien dire. Souvent, parlant pour ne rien dire, on révèle tout de nous. Surtout quand nous sommes dans le désarroi, quand nous nous sentons si mal que nous ne trouvons pas les mots. Il faut dire ce qui nous passe par la tête. Il faut le dire tant qu’il en est encore temps.
Lorsque je me retrouve seule sur la plage, je pense aux ballades que nous avons faites ensemble, toi, moi, Patrick, Igor, Sophie, et Guillaume, à toutes ces déambulations à marée basse entre les rochers et les mares phosphorescentes. La plupart du temps nous avancions serrés, luttant contre le vent, mais il arrivait parfois que chacun parte de son côté, en quête de solitude pour mieux se livrer à ses pensées. Je revois sans cesse cet après-midi de novembre, dont toi-même tu ne peux te souvenir, parce qu’il ne s’est rien passé. En réalité, tout s’est passé dans ma tête. Tu marchais devant moi, précautionneusement, à cause des silex et des algues t’aidant de tes bras pour t’équilibrer. Je me souviens, tu portais des moufles rouges et un bonnet à pompon. Je ne sais pas pourquoi, j’ai voulu soudain t’avouer que je croyais ne plus aimer Guillaume : j’avais l’impression de m’éloigner de lui, je n’éprouvais plus le besoin de l’embrasser, je n’avais plus envie de rire à ses bêtises. Et puis, j’ai pensé que j’étais idiote, que mes raisons étaient puériles, et j’ai laissé tomber.
Maintenant que tu n’es plus, que je suis toujours avec Guillaume, que je sais définitivement que je ne l’aime pas, que certainement il est trop tard pour le quitter, je te revois échapper aux algues et aux silex, marcher librement sur le sable puis courir, courir vers la mer, t’éloigner inexorablement de moi, si bien que ce jour-là j’ai renfermé mes pensées dans leur coquille, si bien qu’à partir de ce jour mes sentiments se sont fossilisés.
Les Valleuses | III
De tous mes enfants, tu étais le plus calme. Je ne dirais pas : le plus gentil. Tu m’échappais constamment, et non pas en t’opposant, mais simplement en ne te confiant jamais, et surtout en répondant très peu à mes caresses. Toujours tu étais absent : on te parlait, tu répondais, mais on ne t’atteignait pas. Je t’appelais « ma petite montagne à moi ». Tu étais si calme que je n’ai pas compris qu’un volcan bouillait en toi.
C’est toujours la même image qui me revient. Nous avions décidé de pique-niquer dans la forêt parce que sur la plage le soleil brûlait trop fort. J’avais sortie la toile cirée, le pain, la charcuterie, le beurre, les jus de fruits, et puis les cornichons. Tu adorais les cornichons. Je te revois en prendre un gros et l’emporter avec toi dans la clairière. Tu n’avais pas trois ans. Tu as levé le bras, tu as mis le cornichon en pleine lumière, et tu l’as regardé comme si ça avait été le bon dieu ou je ne sais quoi : un regard indéfinissable, mais sidérant, porteur d’une joie inimaginable. Sauf qu’aussitôt tu as avalé le cornichon et que tu es redevenu un petit garçon comme les autres. J’avoue guetter ce regard chez les enfants de tes frères et sœurs, mais jamais il n’a reparu. Sûrement qu’il venait de l’intérieur, qu’il avait trouvé sa source dans un petit coin perdu de toi-même, là où je n’ai pu aller puisque je n’ai jamais trouvé le chemin.
On dit que je suis forte, mais moi je sais que c’est grâce à ce regard, que si jour après jour il ne m’avait pas portée, jamais je n’aurais supporté ce que la vie m’a fait endurer. Personne d’autre que toi ne peut comprendre ce que je veux dire. Je ne veux pas passer pour une folle. Je suis une mère comme une autre. J’ai simplement accouché d’une montagne qui un soir n’a pu faire autrement que d’exploser.
Les Valleuses | IV
Ma grande sœur chérie, si tu savais ce que les hommes font de la mer, du ciel, des animaux, des arbres, si tu savais ce que les hommes font des hommes, tu te demanderais comme moi pourquoi ils ont été créés, et si en réalité toute création n’est pas faite pour être détruite. Nous qui, lorsque nous étions enfants, pensions vivre dans un monde parfait, devrions aujourd’hui admettre que non seulement il ne l’est pas, mais que vouloir l’améliorer relève de l’illusion, d’une illusion à laquelle je ne peux, sans céder au désespoir, me débarrasser.
Te souviens-tu du jour où nous nous sommes baignés sous les éclairs et les coups de tonnerre ? C’était grandiose, c’était fascinant. Je ne voulais pas t’obéir, si bien que tu as eu du mal à me faire sortir de l’eau ! Il ne pleuvait pas encore lorsque nous avons quitté la plage, mais il restait tout le chemin à faire ! Je revois cette femme qui sein nu allaitait son enfant, et je me demande encore si je ne l’ai pas rêvée, tant cette vision me parait irréelle et insensée. Le ciel était noir, tirant sur le violet, et la mer, vert émeraude. Nous avons pris à travers prés, et c’est là que j’ai eu envie de pisser. Tu me disais de me dépêcher, mais moi j’avais envie de contempler à loisir la nature qui se tordait sous les assauts de la tempête. Alors, devant mes yeux médusés, la foudre s’est abattue sur un arbre qui a pris feu aussitôt, comme une allumette au bout de laquelle montait une immense flamme.
Ce jour-là, j’ai compris que je n’étais rien du tout, un fétu de paille que le vent déchaîné poussait en avant. Tu avais beau me tenir par la main, j’avais l’impression de fuir le Paradis, d’être en route pour l’Enfer. Mais tu n’as jamais lâché ma main et tu m’as mené à bon port, là où c’était calme, là où j’ai pu me réfugier dans mes illusions, là où je suis encore, me demandant si j’ai tort ou raison.
Les Valleuses | V
Papa, les chiens aboient et la caravane passe. Ta phrase favorite. Du plus loin que je me souvienne, tu disais toujours ça. Aujourd’hui, c’est moi qui te le dis. Je sais, ce n’est pas très original, mais au moins, c’est toi qui me l’as transmis. Et puis, j’avais envie de te parler et je ne sais pas trop quoi te dire. Comme toujours, diras-tu. Aussi, je répète : les chiens aboient et la caravane passe. Et c’est vrai: même si tous les autres me disent que j’ai tort, je continue à penser ce que je veux. Je suis têtu, diras-tu, mais je ne suis pas le seul, si tu veux suivre mon regard. Et puis, si je pense profondément que j’ai raison, pourquoi devrais-je me ranger à l’avis des autres?
Papa, il faut bien que je fasse sans toi. J’y parviens, ne t’inquiète pas. Mais des fois, j’ai peur qu’il m’arrive une chose terrible, du genre : je me noie et tu n’es pas là ! Comme quand j’avais sept ans, si tu vois ce que je veux dire. Le jour où je ne sais pas ce qui m’a pris : quand j’ai bu la tasse une première fois, quand j’ai bu la tasse une seconde fois, quand soudain une vague m’a emporté, quand je n’ai plus eu pied, quand j’ai bu la tasse une troisième fois, quand j’ai battu désespérément des mains, quand la mer autour de mon cou enflait et désenflait, quand je me suis retrouvé seul au milieu de nulle part, quand j’ai bu la tasse une quatrième fois, quand soudain je me suis retrouvé au creux de tes bras, quand enfin j’ai entendu ta voix, rassurante comme une berceuse, cette voix qui depuis n’a cessé de m’accompagner, qui me dit quand il faut y aller, qui m’assure que je n’ai rien à craindre. Au fond, je sais qu’il n’y a pas de raison qu’un truc de ce genre m’arrive de nouveau, mais c’est plus fort que moi, j’ai peur quand même ! Les chiens aboient et la caravane passe. Papa, si un jour elle ne passait pas ?
Les Valleuses | VI
Quoi de neuf, ma couleuvre ? T’as rien à raconter ? Moi non plus, figure-toi ! Depuis l’année dernière, il ne s’est rien passé. Ah si, j’ai trouvé du boulot ! Ce n’est pas top mais c’est du boulot. Autrement, ma femme va bien, les enfants grandissent, la voiture n’a pas encore lâché, des petits soucis avec la chaudière mais ça s’est arrangé, rien, quoi ! Tout va bien, et pourtant je suis enragé, je suis toujours en colère ! Ça ne changera jamais ? Je te crois, ma couleuvre. Pourquoi ça changerait ? Mais je suis content de t’avoir, j’aime te causer. On se connaît depuis combien de temps, toi et moi ? Quel âge j’avais quand il y a eu tout ce ramdam ? J’entends encore ma sœur pousser un cri de tous les diables ! Crois-moi, tu aurais mieux fait de ne pas te réveiller. Je revois mon père s’emparer d’une grosse pierre et commencer à t’écrabouiller, à te faire la peau, ma couleuvre, et moi qui lui criais d’arrêter, qui hurlais comme une sirène à midi, moi qui sous le cagnard ai fini par faire une crise ! Il a fallu ensuite que ma mère intervienne, et Dieu sait si ça pas été facile de convaincre mon père de t’enterrer. Je sais, nous sommes une famille d’hystériques ! Que veux-tu, tu es mal tombée.
La rage est lovée au fond de moi et je n’arrive pas à la faire sortir : j’ai peur de ce qui pourrait arriver, j’ai peur de ne pas pouvoir me contrôler. C’est sans doute parce que je ne sais pas d’où elle vient. Personne ne m’a mordu, jamais personne ne m’a frappé —pas même mon père— mais c’est la vérité, j’ai envie de tout bousiller. Alors, j’écoute ma mère. Elle dit qu’il faut accepter, elle dit qu’il faut être réconcilié. Je ne comprends pas très bien ce qu’elle veut dire, mais il me semble que tu tiens dans ce mot, ma couleuvre, que « réconcilié » te va comme un gant. Ça me donne chaud au cœur de me glisser dans ce gant. J’ai alors l’impression qu’en moi la rage dort profondément.