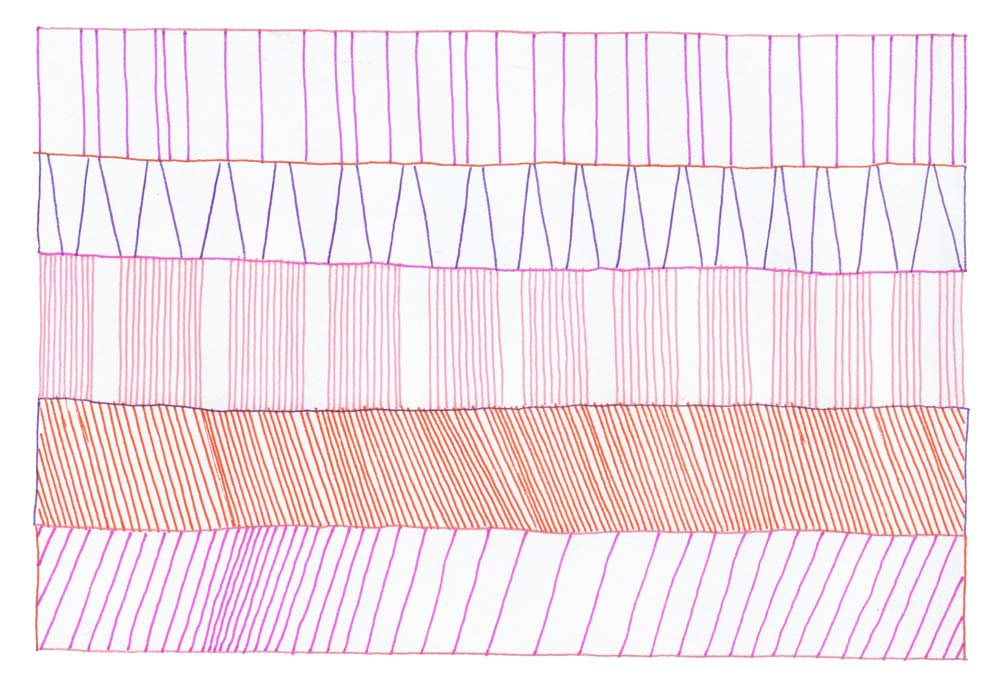
On me disait têtu et obstiné. Ils pouvaient être mille contre moi, je gardais ma pensée. Bien sûr je m’examinais, je tâchais de comprendre pourquoi les mille avaient de toutes autres pensées. Mais si toujours je croyais être dans le vrai, alors il n’y avait plus rien à faire, personne ne pouvait me faire entendre raison. Têtu, peut-être, mais pour moi c’était une forme de résistance. J’agissais en mon âme et conscience. Ma pensée m’appartenait, j’en étais le seul responsable.
Quelque chose en elle me poussa un jour dans les bras de l’armée.
Ce que je fus alors, on le nommait appelé. Appelé : on a soi-disant besoin de toi et une voix prononce ton nom. C’est une espèce qui a disparu, qui déjà à l’époque était en voie de disparition. Dans mon entourage, il n’y a pas grand monde à avoir fait l’armée, et les quelques cas sont du type « planqués ». Moi, pour ne pas faire comme les autres, je me suis retrouvé dans un camp semi-disciplinaire.
Quand je dis « je me suis retrouvé », c’est ma faute, j’ai répondu à l’appel. Au psychiatre qui me posait la question, j’ai répondu « oui, je veux faire l’armée ». Même à eux, surtout à eux, ça ne paraissait pas évident. J’étais au milieu de mes études de sociologie et c’est probablement pour cette raison qu’ils m’ont convoqué chez ce psychiatre que je n’avais pas demandé. Ce dernier a dû se dire : « Ok, si tu veux faire l’armée, c’est que tu veux en baver », et je me suis retrouvé loin de Nantes, près de la frontière belge, dans une sorte de bout du monde, un no man’s land idéal pour jouer à la petite guerre. Camp de Sissonne, c’est le nom de l’endroit. Qu’y avait-il dans la voix pour que je réponde à l’appel ?
Il y avait sans doute le désir de me mettre moi-même à l’épreuve, sans doute aussi la volonté de ne pas échapper à la loi commune. J’étais un intellectuel mais je n’étais pas que ça. Et puis, j’avais le goût des expériences. J’avais sûrement envie de voir comment j’allais réagir, précipité dans une situation extrême pour moi, tout à fait en dehors de mon univers. Je n’avais jamais touché à une arme, je n’allais pas voir les films de guerre et j’ai très peu joué aux petits soldats. Je me souviens que mon père était désemparé.
Mon père avait fait la guerre d’Algérie. Il n’en parlait jamais et je ne lui ai jamais rien demandé. Mais il savait que l’infanterie, c’était le pire que je pouvais demander.
Un camp n’est pas une caserne. Quand le jour s’enfuit, vous ne pouvez pas en sortir. Vous le faites une fois pour marcher jusqu’au village le plus proche mais vous ne le faites pas deux fois. Il n’y a rien à voir et il n’y a rien à faire. Moi qui jusqu’à ce jour ignorais l’ennui, j’ai fait connaissance avec ce vide qui parfois s’installe entre nous et notre pensée.
Je n’avais jamais vu de ciel si bas, si lourd, pesant tout à fait comme un couvercle. Et l’hiver fut rude comme je n’en ai pas connu depuis.
Mais je fus « planqué » à ma manière : ils avaient besoin de radios, à l’issue des classes j’entrai dans le service Transmissions. Là, j’appris un nouveau langage, celui des ti (grosso modo l’équivalent d’une noire) et des ta (l’équivalent d’une blanche). Je savais l’alphabet qui va d’Alpha (tita) à Zoulou (tatatiti). Je savais traduire la musique en messages que l’on transmettait aussitôt aux instances supérieures. Nous étions surtout utiles quand il s’agissait de jouer à la guerre. Par exemple, on passait le message « un gaz toxique avance sur nous », et si peu après le colonel nous surprenait sans masque à oxygène, on devait aussitôt s’allonger et jouer les morts. Voilà à peu près à quoi je servais. J’ai du mal à imaginer ce qu’il en aurait été en temps de guerre : la vraie, celle qui avance sur nous sans s’annoncer.
Nous dînions vers six heures, ensuite on occupait comme on pouvait la soirée. Notre adjudant, rondouillard et débrouillard, avait réussi à fourguer aux gars d’avant une télé, par conséquent notre chambrée était de loin la moins tranquille et la plus visitée. Par un fait exprès je dormais en haut d’un lit superposé et me trouvais au niveau de la télé posée sur une armoire métallique. J’avais donc la tête tout contre, ce qui ne m’empêchait pas d’avoir toujours un livre à la main: dans le brouhaha je parvenais à comprendre ce que je lisais car ce que je lisais m’aidait à résister. Je me suis ainsi nourri de tous les essais de Montaigne. Ses leçons de stoïcisme m’étaient hautement profitables tandis que me parvenaient les échos de Santa Barbara.
J’étais différent, mais j’avais ma place dans le groupe. Quand il le fallait je savais boire ma quinzaine de bières. Je pourrais vivre dans n’importe quelle communauté du moment qu’on accepte que par quelque côté je m’échappe. Je joue toujours le jeu mais jamais jusqu’au bout. On peut appeler cela de la réserve.
J’ai découvert là-bas un monde que je ne connaissais pas, j’ai rencontré des gars inimaginables. C’est là que j’ai appris que j’étais un privilégié. C’est là que j’ai compris à quel point l’intelligence était une arme redoutable. C’est sûr, il faut bien se défendre, d’une manière ou d’une autre il faut se faire respecter. Mais quel est-il, celui qui abuse de son intelligence, celui qui manipule les autres à seule fin de s’en tirer ? Un maître de marionnettes ? A-t-on le droit de transformer en marionnette l’être de chair et de sang réduit à dire ce qu’on veut lui faire dire et qui agit comme on l’entend ? Que devient dans les mains de l’écrivain celui dont maintenant il me faut parler, celui qui a voulu que j’en parle, qui a voulu que je le mette par écrit, celui que j’espère ne pas avoir manipulé, celui que malgré tout maintenant je manipule, celui qui dans ma mémoire est désormais devenu le passeur, le seul rôle qu’il ait jamais joué dans ma propre vie qui dans la réalité est la seule qui compte, la seule que je ne peux trahir puisque c’est ma réalité, mais qu’est-ce que ma réalité sans les autres, sans lui en particulier ?
Puisqu’il faut y aller, je vais aller tout de suite à la caricature. Ce garçon, c’est Quasimodo. Quand j’écris ça, je n’ai pas l’impression d’exagérer. Une brute au teint rougeaud, la face taillée à coups de poings, des mains énormes. L’impression d’une violence qui n’est pas complètement parvenue à rentrer au dedans et qui se lit dans tous les accidents du corps. Bête mais au fond pas méchant. Les sections combattantes n’en ont pas voulu, il s’est retrouvé dans notre service comme homme à tout faire alors qu’il n’y a rien à faire. Je ne sais plus son nom. Forçons le trait. Allons-y pour Quasimodo. Un Quasimodo aux petits yeux bleus et aux cheveux blonds. C’est à peine si j’exagère.
Nous allons voir ailleurs, nous faisons une virée au Larzac. Nous voyageons dans un VAB. Nous traversons des villes. Par les petites lucarnes du fond j’aperçois des gens qui sont libres. Nous avançons blindés mais quand même, je n’ai jamais désiré à ce point la liberté. Rien que le bonheur de marcher au soleil…
Je ne sais pas ce qu’il lui prend mais Quasimodo m’envoie au visage un bout de pain bien sec. Il me fait mal et je renvoie le bout aussi sec. Branle-bas de combat. Heureusement les autres sont là et parviennent à le calmer.
Le soir même, ou le lendemain, je suis de garde. Ça veut dire : veiller la nuit au cas où un message arriverait. Comme nous ne sommes pas assez de radios, on nous adjoint à chacun un conducteur qui toutes les quatre heures nous relaie. Si musique se fait entendre, il réveille le radio qui dort. Moi, j’écope de Quasimodo.
Tout s’est passé comme en rêve. J’aurais pu mal dormir mais en réalité je crois que j’ai très bien dormi. Je n’ai eu aucun mal pour le réveiller et lui-même pour me secouer l’épaule fut la douceur incarnée. Au matin, il me dit: « Promets-moi qu’un jour tu me mettras dans un de tes livres, promets-moi que tu parleras de moi. » J’ai promis. Je croyais que ça ne m’engageait à rien. Une vague promesse, ça ne mange pas de pain.
A cette époque, autant que je m’en souvienne, il n’était pas du tout question que j’écrive un jour. C’était probablement là mais ça ne m’était pas venu à l’esprit. Tout ce que Quasimodo connaissait de moi, c’était ce qu’il avait pu voir, c’était moi en train de lire, moi plongé jusqu’au cou dans les livres. Mon corps était là mais ma tête ailleurs. Ma tête était préoccupée par les mots au point de les faire siens, de les amalgamer jusqu’à oublier leur origine, jusqu’à avoir l’impression de les faire remonter du fond de ma propre pensée. L’écrivain n’était plus qu’une sorte d’intercesseur, le point d’appel à partir duquel je prenais mon élan, sautant hors de la page pour finalement me retrouver au sein de ma réalité —encore une fois la seule qui compte, la seule grâce à qui je peux me repérer, la seule qui me donne une place dans la réalité, celle des autres.
Lire et écrire sont probablement une seule et même chose. Ce qu’il faut pour lire est ce qu’il faut pour écrire. Bien sûr, lire vraiment, s’investir, ne pas laisser sa personne à la porte, et bien sûr, tout autant, écrire vraiment, une fois passée la porte explorer tout à fond. Il n’y a pas de différence. Juste une question de volonté, ou de patience, ou d’inconscience… On lit comme on écrit, en se découvrant.
A l’époque, je ne comprenais pas. Qu’avais-je dans la tête à l’époque —quand nous passions nos journées dans le hangar à laver des véhicules qui ne sortaient guère— qu’avais-je dans la tête quand nous défilions baïonnette au canon, mon œil droit à portée de la baïonnette de mon voisin de droite qui avait du mal à marcher au pas— pensais-je à quelque chose quand vers quatre heures du matin je courais pour être parmi les premiers à sauter dans le camion, pour ne pas attendre dans le froid le retour de ce dernier, pour pouvoir être au lit plus tôt— n’avais-je pas la tête totalement vide quand je transcrivais des messages dont le sens m’était indifférent ?
Je crois en effet que je suis sorti de là la tête vide. J’ai poursuivi mes études mais je n’y croyais plus. Je ne croyais plus au jeu social, je ne comprenais plus l’intérêt de faire de bonnes études et d’avoir un métier respectable. Je m’étais vidé de cela. Mis en disponibilité. N’ayant en fin de compte qu’une envie : marcher librement sous le soleil. Malgré moi j’étais dans la situation de celui qui renonce à la vie normale pour être en mesure de recevoir quoi, qui, Dieu ? Il y a de quoi rigoler. Mais c’est quand même comme ça —à cause dans ma vie de ce trou d’un an par lequel mon envie de réussir avait dégringolé, comme une fuite d’eau qui dévale les marches— que peu à peu je me suis mis à écrire, pour combler mon manque de croyance en la réalité telle que désormais elle se proposait— une comédie told by an idiot, signifying nothing—pour ne faire qu’un avec ce que j’avais en tête, cette nouvelle réalité à laquelle je ne pouvais que me raccrocher et que j’espérais partager en la donnant à lire, cette réalité appelée imagination qui d’être issue de mon cerveau n’en est pas moins vraie que l’autre, puisque c’est penser qui compte, puisque l’existence tout entière se tient dans notre âme et conscience.
On me suggère à l’oreille que j’ai peut-être exagéré. Ti-ta—tititi-titi, titatiti-ti-tatitati-ta-ti-titita-titati, ta-titita—tita-tititita-tita-titi-tititi—ti-ta-ti—tata-tita-tati-titi-titatati-titita-titatiti-ti ? Mais au moins aujourd’hui j’ai tenu ma promesse.
